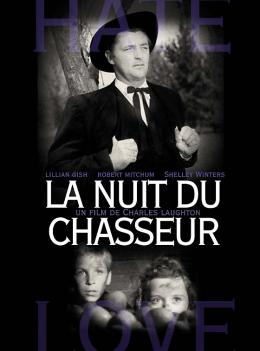Le Mal incarné. L'innocence imagée.
"Hate" : un faux prêtre assassine ceux qui n'entrent
pas dans les canons de la Sainte Bible. Et les veuves.
"Love" : deux jeunes enfants emportés tant
bien que mal dans le tourbillon d'une vie agitée par
la grande pauvreté et tout ce qu'elle engendre.
Il fallait oser ce grand écart cinématographique
dans les années 50, il fallait entreprendre ce genre
(le thriller, mais pas n'importe quelle thriller...), il fallait
envisager cette thématique religieuse, il fallait produire
ce film au style sans commune mesure. On imagine à quel
point ce devait être une oeuvre dure pour l'époque
(pas sortie aux USA ?), le piège se refermant violemment
sur deux pauvres enfants, ne les épargnant jamais, l'homme
de Dieu incarnant le Mal à l'état pur dans une
société profondément religieuse. C'est
également une réflexion sur le pouvoir malfaisant
de l'argent, la pauvreté dans un contexte historique
difficile. La lutte éternelle du Mal contre le Bien ou
quand l'expression "La beauté du Diable" n'a
jamais été aussi bien interprétée.
Mais développons un peu.
Ce qui surprend de prime abord dans ce film c'est que l'histoire
n'est absolument pas racontée de manière classique,
linéaire, et on ne sait encore trop qui en sera le héros.
Il y a ensuite, et constamment, un parfum de souffre qui souffle
sur le scénario : depuis la description de ces mauvaises
gens (le père -excusable-, le pasteur) jusqu'au coeur
de ces histoires de foi excessive. Il y a également une
multiplication des personnages (le véritable héros
s'avèrera être un enfant) et surtout des points
de vue ; les enfants sont ici les détenteurs d'une vérité
trop lourde pour leurs fragiles épaules, les adultes
restant aveuglés par le costume de ce bonimenteur hypocrite,
pervers et dangereux.
Vous le comprendrez aisément : La nuit du chasseur
est un film d'une immense richesse, au scénario
quasi métaphorique et possédant divers niveaux
de lecture dont le plus moderne pourrait très bien s'apparenter
à une réflexion sur l'extrémisme religieux
: le personnage principal n'est qu'un usurpateur, paré
d'une solide coquille pseudo-religieuse dont il se sert pour
commettre le pire (le meurtre, l'enrichissement par tous les
moyens...etc) ; contrebalancé bien évidemment
par la vieille dame de la fin qui devient la représentation,
l'essence même de la religion (donner son temps aux orphelins,
protéger les pauvres et les innocents,...etc).
Dans cette Nuit du chasseur la violence du
récit heurte inévitablement le spectateur : la
force de l'âge adulte contre la faiblesse de l'enfance,
l'intelligence et l'expérience contre l'immaturité
et la naïveté (l'adolescente attirée par
cette incarnation du Mal), le machiavélisme contre la
candeur. A noter également l'utilisation d'un autre symbole
fort de l'innocence : les animaux. Ce Mal, qui plus est, prend
le visage d'un Robert Mitchum totalement imbibé par son
rôle, pour un suspens diablement efficace et des séquences
extrêmement tendues. Sans oublier cette chanson presque
obsessionnelle, proprement divine.
Et puis, bien sûr, ce que l'on garde gravé en nos
mémoires, ce qui fait définitivement basculer
le film dans le domaine du chef-d'oeuvre, c'est le travail de
C. Laughton, unique incursion dans ce domaine de la part de
ce fameux acteur. Un véritable travail de peintre basé
sur la profondeur de champ, les ombres sans cesse portées
et la beauté significative des images ; images dont la
photographie flamboyante participe à cette ambiance inquiétante
et menaçante. Aidé de ces lumières et de
ces ombres jouant avec le noir et blanc, de cette caméra
en perpétuelle recherche et de la beauté et du
sens. Il y a des plans nocturnes de toute beauté, d'une
beauté formelle rarement égalée : les scènes
crépusculaires sur le lac sont proprement extraordinaires,
notamment grâce à l'emploi de contre-jour et l'utilisation
judicieuse des décors.
On ne vous a jamais aussi bien raconté l'histoire du
Bien et du Mal. A la fois effrayant et envoûtant : j'emmettrai
seulement certaines réserves sur le jeu de S. Winters...
NOTE : 19-20 / 20