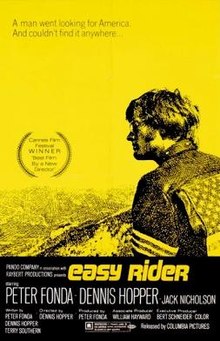A décréter une oeuvre cinématographique
et son auteur "visionnaire", trop vite, trop tôt
et souvent sans grands arguments, on déprécie
la force et la portée même de ce mot. Mais 50 ans
après sa sortie, Easy rider est non
seulement culte, bien vivant, moderne, mais également
visionnaire. Et il est selon moi l'un des 10 plus grands films
de tous les temps.
Il faut d'abord jeter un regard en avant sur ces 2
personnages, Billy le farfelu et Wyatt l'intellectuel, dit "Captain
America", clin d'oeil autant à la pop culture qu'une
façon de secouer l'arbre de la fierté nationale
légendaire outre-Atlantique. On ne saura que très
peu de choses sur eux finalement : ils disent n'avoir qu'une
semaine pour faire leur voyage, on imagine que si celui-ci échoue
ils vont devoir rentrer dans le rang d'une société
qui leur a octroyé une semaine de congés ? Billy
est un hippy, drogué qui n'a qu'une seule chose en tête
: profiter de la vie quoiqu'il arrive ; en clair s'envoyer en
l'air de toutes les façons possibles et imaginables,
drogue et sexe, comme pour oublier une existence terne. Ces
deux là n'ont pas l'air de véritables dealers,
contrairement à ce que l'on pourrait croire au tout début,
mais plutôt de deux gars qui veulent profiter une dernière
fois du système pervers de cette société
mercantile pour s'enrichir et laisser leur existence couler
comme bon leur semble. En Floride.
Wyatt est plus subtile, plus sensible, plus sensé : tête
pensante du duo, il est celui qui amène toute la réflexion
-sur laquelle on reviendra- du film, l'espoir ("Ils y arriveront"),
la critique sociétale et même personnelle ("On
s'est paumé"). Le duo sera vite complété
par le personnage hilarant -mais pas seulement- de Georges.
Wyatt se dévoile un peu plus lors de la fabuleuse et
planante scène de trip, où il évoque ce
Dieu auquel il croyait et auquel il aimerait tant croire, croyant
avoir été abandonné, mais aussi ses parents
dont il parait être orphelin de père et dont les
relations avec sa mère ne sont pas... enrichissantes.
Film idéaliste mais très moderne où nos
anti-héros vont traverser l'Amérique de leurs
ancêtres en partant depuis la côté Ouest
-le film est provocateur jusque dans son âme- pour rejoindre
l'Est et faire ainsi le parcours inverse des premiers colons.
Et sur ce chemin ils vont croiser deux visions de leur pays
chéri : d'un côté l'homme de la terre, fier
paysan qui procrée et enrichit le pays avec ses enfants,
mais également la communauté hippie qui tente
de faire exister une nouvelle société, centrée
sur les artistes, en se nourrissant de la terre et revenir ainsi
aux racines de l'Amérique. De l'autre côté
il y a l'Amérique raciste, blanche, sudiste, hideuse,
avec les redneck mais également les symboles autoritaristes
que sont ici les policiers. On ne verra aucun enfant dans ce
monde là. Près de 50 ans plus tard la population
n'a clairement pas changé et le message du film n'a pas
été entendu, ou a été oublié
: l'Amérique blanche de Trump fait front avec ces nouveaux
américains -un temps symbolisés par B. Sanders-
qui souhaitent se lancer dans une nouvelle société,
plus écologique, plus juste et surtout plus libre. Un
retour aux fondements de l'Amérique.
Le personnage de Georges apporte par ailleurs sa pierre à
l'édifice. Il y a bien sûr son aspect de surface,
comique formidable où une seule de ses scènes
vaut toute la filmographie de Boon. Mais il ne faudrait pas
oublier cette séquence charnière, explicative,
où il confie à Billy que la haine de ses concitoyens
provient de leur peur -et les américains du 21ème
siècle sont toujours gouvernés par la peur-, peur
de la personnalisation du changement que sont ces deux hommes,
d'une liberté qu'ils ne peuvent, eux, américains
moyens du Sud, pas atteindre et qui les effraie tout autant.
Notons que le film trouve sa pierre d'achoppement lors de la
scène, hautement symbolique, de trip dans le cimetierre
: ici sont confrontés le sexe et la mort, Eros et Thanatos,
la religiosité et le doute païen, la double perte
du "père", biologique et spirituel, et surtout
la prise de conscience tardive de Wyatt. En se vouant au plaisirs
terrestres et vains, dans lesquels ils ne semblent d'ailleurs
jamais vraiment se plonger, ils se sont tout deux égarés.
La terrible conclusion, hautement pessimiste du film, où
nos héros idéalistes sont rattrapés par
l'Amérique régressive -et le message est d'autant
plus douloureux en 2017-, trouve un bel écho dans le
sublime plan final dont nous allons reparler ci-dessous.
Et puis il y a, enfin, tout l'aspect visuel extrêmement
riche du film. Car Easy rider est tout autant
une oeuvre réflexive que formelle, et les deux s'enchevètrent
de la plus intelligente des manières. Si on trouvera
quelques maladresses, aujourd'hui parties intégrantes
de l'oeuvre et de sa légende, de son charme intemporel,
il est difficile de résister à ces enchaînements
entre scènes, comme une invitation au voyage, difficile
de céder au bonheur devant cette subtile juxtaposition
de plans dans le cimetierre ; difficile de ne pas comprendre
le symbolisme génial lorsque les deux motards réparent
leur roue aux côtés de deux fermiers qui scellent
leur cheval. Et, pour y revenir, alors que ce film se joue toujours
à niveau d'homme, au niveau de la route, comment ne pas
comprendre ce dernier plan où la caméra daigne
enfin s'élever dans les cieux juste après l'accident
??
Easy rider et son cortège de scènes
planantes (non simulées !), sa bande son cultissime et
loin d'une bande originale "jukebox" car formidablement
bien choisie (il suffit d'écouter les paroles des chansons
en présence pour entendre penser l'auteur), Easy
rider est une oeuvre indémodable qui serait
juste de présenter comme avant-gardiste et surtout ne
jamais, jamais oublier...
L'un des 5 plus grands et plus importants films de l'histoire
du cinéma